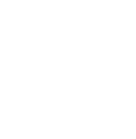Pour nous tous, l’eau est un bien précieux. À la demande du Conseil municipal, la Station de biologie des Laurentides (Université de Montréal) a entrepris, en 2002, l’étude de plusieurs de nos plans d’eau dans le but d’établir un carnet de bord qui servira aux observations futures, d’identifier et de comprendre les sources de détérioration de la qualité de ces lacs et finalement, d’émettre des recommandations visant la saine gestion des lacs et de leurs bassins versants. Étude Carignan États des lacs 2003
En 2007, un second mandat a été donné à la Station de biologie des Laurentides pour procéder à un suivi de l’état des lacs étudiés en 2001 et 2002 et surveiller l’évolution de leur santé. Étude Carignan 2007
En 2012, le Conseil régional de l’environnement des Laurentides, en collaboration avec les associations de lacs et la Municipalité, a élaboré les Plans directeurs des lacs Bleu, de l’Achigan, en Cœur et Morency, afin d’identifier les enjeux et les problématiques spécifiques de ces lacs et de leurs bassins versants, ainsi que de convenir, en concertation avec les acteurs concernés, des actions à poser afin d’améliorer ou de préserver la santé de ces lacs. Plan directeur lac Bleu , Plan directeur lac de l’Achigan , Plan Directeur lac Morency , Plan directeur Lac en Coeur
Le Plan directeur du lac en Cœur a par ailleurs fait l’objet d’une mise à jour en 2018 grâce au partenariat avec le CRE Laurentides et l’Association du lac en Cœur .
En 2018, les 14 lacs de Saint-Hippolyte ayant déjà été examinés en 2002 et 2007 par la Station de biologie ont été revisités par le Dr Richard Carignan afin d’en établir l’évolution. À quelques exceptions près, les résultats montrent une amélioration générale attribuables aux efforts déployés par la Municipalité depuis 2008 pour assurer la protection des plans d’eau se trouvant sur son territoire. Pour consulter les résultats de cette étude, cliquez ici.